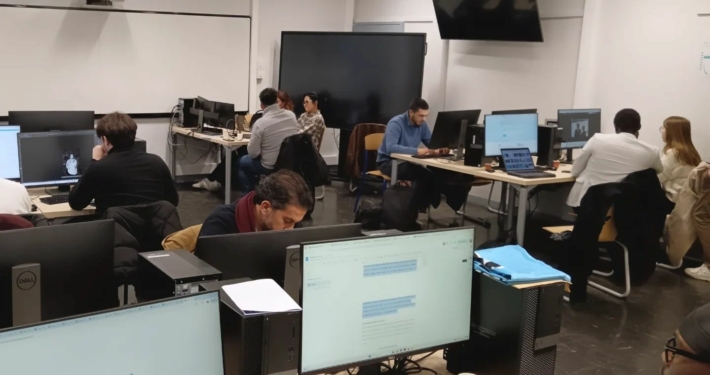“Ni oubli, ni pardon” – Portrait de Mohammed, photojournaliste syrien
Le jeune homme qui vient à ma rencontre dans le hall de la Maison des Journalistes est radieux. Tasse de thé fumante dans une main et tongs aux pieds malgré les températures glaciales de l’automne parisien, un doux sourire illumine son visage. Poli, Mohammed s’excuse pour sa douzaine de secondes de retard.
Malgré un statut de journaliste reconnu comme photographe international, Mohammed est d’une très grande humilité. Sur un ton tranquille mais décidé, il se présente à moi avant tout comme un être humain, puis comme un Syrien et finalement, l’une des nombreuses victimes de la guerre.
Devenir photojournaliste et se sentir utile
Devenir photojournaliste n’était ni une aspiration, ni une idée. Avant la guerre, il y n’y avait aucun photographe dans sa communauté. D’ailleurs, sa première inspiration professionnelle n’avait rien à voir, il souhaitait devenir architecte. C’est l’un des premiers rêves volés par la guerre. La révolution syrienne et le conflit qui a suivi l’ont empêché de découvrir le monde universitaire.
«De plus en plus de roquettes détruisaient la ville de Douma, mais mon université n’a pas fermé. Y aller ? Cela signifiait que tu risquais directement ta vie.»
La ville de Douma dont il est natif fait partie de la douzaine de villes assiégées, situées dans l’Est de la Ghouta. Le gouvernement syrien a ainsi piégé plus de 400.000 civils, avec pour objectif d’enlever les forces d’opposition de la région. Dans une zone où les raids aériens et les attaques aux armes chimiques se succèdent, les amis de Mohammed lui posent toujours la même sempiternelle question:
“Qu’est ce qui se passe? – Qu’est ce qui se passe? – Qu’est ce qui se passe?”
Pour répondre à cette question, Mohammed a estimé que les mots ne suffisaient pas. En revanche, la photographie pouvait retranscrire la douleur qui ravageait sa région.
“Je ne me sentais plus utile à force de ne pas savoir comment aider les blessés. Prendre des photos m’a donné une nouvelle raison d’être. J’ai pu, par mon travail, répondre à la question ‘qu’est ce qui passe ?’ même quand la réponse était difficile et pénible à regarder.”
Ne plus être à l’université, c’est aussi avoir du temps “libre” : qu’il consacre à être sauveteur aux premiers secours avec le Croissant Rouge (équivalent de la Croix Rouge). Mohammed est alors déterminé à aider les victimes qui sont aussi ses voisins, vendeurs de rue, professeurs, médecins et même des membres de sa famille. Face à eux, il a appris à camoufler et à retenir ses émotions. Malheureusement, il a aussi découvert son manque de connaissance médicale.
Comme une blague récurrente, des volontaires aux soins lui suggèrent de se contenter de prendre des photos plutôt que d’essayer d’aider les blessés. Sans y penser à deux fois, il se rend utile et commence à documenter la guerre. Au delà des images qu’il envoyait à ses amis inquiets, il se rapprochait de la vérité du quotidien sous les décombres, dans les rues ou dans le centre médical.
“Je ne me sentais plus utile à force de ne pas savoir comment aider les blessés. Prendre des photos m’a donné une nouvelle raison d’être. J’ai pu, par mon travail, répondre à la question ‘qu’est ce qui passe ?’ même quand la réponse était difficile et pénible à regarder.”
Mohammed prit alors son temps pour continuer son récit. Une inspiration profonde l’aide à se retirer mentalement des souvenirs sombres qui l’entourent.
“J’étais devenu une caméra, un robot, prenant des photos les unes après les autres. Photographie après photographie. Je me suis alors isolé de mes proches: c’est mieux d’être seul dans la guerre. C’est mieux d’être solitaire en enfer.”
Ses premières photographies accréditées ont été prises à ses vingt-trois ans. Dès ses vingt-cinq ans Mohammed est devenu un journaliste professionnel accrédité par l’European PressPhoto Agency (EPA) pour lequel il travaille encore aujourd’hui.
En zone de guerre: quelle éthique pour le photojournaliste?
Petit à petit, le regard des autres change. De photographe amateur il devient un vrai professionnel. Reconnu, Bassam Khabieh l’encourage à être l’un des rares artistes à conter Douma et à documenter les attaques du gouvernement contre les civils.
Les conflits imposent aux photojournalistes un voyeurisme de l’horreur.
Il n’y a ni tableau blanc, ni stylo, ni livre dans le processus mais plutôt de longues discussions sur l’éthique du travail.
Les conflits imposent aux photojournalistes un voyeurisme de l’horreur: faire intrusion dans des lieux où des victimes sont très vulnérables. Des moments de désespoir où des enfants ensanglantés, des familles séparées ou le passant malchanceux avec une jambe amputée ne souhaiteraient pas forcément être médiatisés.
Le regard de Mohammed change quand il explique ce conflit interne et se perd sur les murs gris de la MDJ. Son côté “robotique” semble reprendre le dessus. Que peut-il bien ressentir au fond de lui?
Il explique ne pas avoir eu le choix. Il n’y avait pas de compromis possible, dévoiler l’intimité des blessés et des morts pour dire honnêtement leur histoires respectives et l’Histoire collective du peuple syrien qui s‘écrit.
“Aucune photographie n’arrête une guerre, mais chacun d’entre nous doit jouer son rôle. Il y a une responsabilité mondiale. Cela ne signifie pas que c’est facile ou innée. Je pense encore aux gens que j’ai photographiés. J’ai une responsabilité en tant qu’être humain, pas en tant que photographe.”
L’exil forcé et l’obtention du visa français
Le 1er avril 2018, il est déplacé de force de la ville de Douma à celle d’Idlib, une ville Nord-Ouest de la Syrie contrôlée par les forces d’opposition qui se battent contre Bachar El-Assad.
Mohammad est parti de Douma avant que Bachar El-Assad ne le force à détruire son travail visant à faire croire que les crimes commis étaient faux. Il ajoute, avec une voix légèrement incertaine, que dix-sept autres casques blancs activistes qui travaillaient à mettre en lumière les horreurs du conflit, ont dû les démentir auprès d’un public international à la Haye aux Pays-Bas.
“Je devais protéger mes photographies. Ce sont des preuves pour les victimes, les preuves d’exactions criminelles dont je suis aussi victime.”
Après quatre mois dangereux à Idlib, loin de tout ce qui était lui familier, il a payé son passage clandestin en Turquie, où il a résidé pendant une année.
A Istanbul, il est confronté à des complications liées au visa, en plus de la langue qu’il ne parle et ne comprend pas. Isolé, Mohammed demande l’asile à la France pour vivre dans un pays où les entités religieuses ne dirigent pas la politique.
Après une année d’attente et beaucoup d’interrogations, Mohammed est sélectionné pour obtenir un visa. Il a conscience de sa chance. C’était trois mois avant cette interview, en juin 2019.
Mohammed admet que même s’il est ici aujourd’hui, valide et intacte physiquement, les dommages psychologiques le guettent.
“Maintenant je ne rêve plus, je découvre et j’essaie de comprendre ce qui s’est passé et quel scénario peut encore advenir. Je suis toujours passionné d’architecture et je vais travailler encore plus en tant que photojournaliste pour peut-être, un jour, retourner à l’université pour finir mes études d’architecte.”
Maintenant, son plus grand désir est d’obtenir la citoyenneté française pour avoir la tranquillité d’esprit, se sentir à sa place légitimement et par la suite reconstruire sa vie petit à petit.
Après un court moment de silence, il attire l’attention sur un tatouage inscrit sur son avant-bras : “ni oubli, ni pardon”. Le regard sombre, il explique que ce mantra est un rappel pour son droit à la justice.